
Une Vie sur le Tapis

Flacking : Quand l’Art Refait le Trottoir

Une Vie sur le Tapis

Flacking : Quand l’Art Refait le Trottoir

The Comedian de Maurizio Cattelan
Pékin, Chine, 28 novembre 2021. La banane attire l’attention des visiteurs au Centre d’art contemporain, dans le cadre de l’exposition-rétrospective «The Last Judgment » consacrée à l’artiste italien.
Histoire absurde. Maurizio Cattelan colle une banane sur un mur en 2019, pendant Art Basel, la Foire d’art contemporain, en 2019. L’artiste déclare que c’est une œuvre qu’il nomme The Comedian. Le galeriste qui le représente la met en vente. La banane collée est immédiatement adjugée à 120000 euros. Quelques tirages photo de l’œuvre et des droits d’auteur sont cédés pour 400000 euros environ.
David Datuna, un artiste qui veut protester contre la faim dans le monde, mange The Comedian. Aucun problème : l’iconoclaste a bien vandalisé une œuvre originale, mais n’a pas détruit le «concept artistique». Le concept donc est présenté et doctement commenté par d’éminents spécialistes dans les plus grandes foires et expositions du monde. La banane arrive à Séoul, où l’attend Noh Hyun-Soo. Le jeune étudiant mange l’œuvre-banane : il a faim, et la banane exposée lui donne l’occasion de combler un petit creux et de «poser un acte de rébellion sur l’acte de rébellion » de Cattelan. Aucun problème, encore une fois, pour l’artiste italien. Ce qui compte, c’est le concept, l’idée et son prix. Astronomique. Que la banane ait été mangée ou pas, l’argent coule à flots. Mais, en Floride, Joe Murford, autre artiste au ruban adhésif, prend la mouche. Lui aussi a collé des bananes sur un mur accompagnées d’oranges et, surtout, il l’a fait avant Maurizio Cattelan. L’Italien qui «se moque de tout » (c’est lui qui le dit) ne rigole plus. L’affaire est sérieuse. On plaide. Un juge finit par absoudre Cattelan. La décision du tribunal est motivée par le fait que les angles d’inclinaison des bananes diffèrent entre les œuvres de Murford et Cattelan.
En moins d’un an, la banane scotchée de Cattelan aura généré au bas mot 500000 euros. Elle aura mobilisé une foule de journalistes, d’experts, d’historiens de l’art, mais aussi des avocats. Tous ces gens ont reçu salaires et honoraires, et perçu des droits. La banane de Cattelan a fait couler pas mal d’encre, et encore plus d’argent! Moins d’un euro de matière première et quelques secondes du temps de l’artiste ont rapporté un million de fois la mise initiale.
DES PRATIQUES DE FINANCIERS
L’art contemporain sert à cela. Aucune industrie n’est plus lucrative. Aucune activité économique ne crée de bénéfices aussi stratosphériques. Pour bien comprendre comment fonctionne le système de l’art contemporain, il faut le rapprocher de l’univers de la finance avec lequel il a de nombreux points communs. Les banques centrales émettent des images, billets de banque et pièces de monnaie, et en fixent la valeur – valeur garantie par les réserves d’or et la solvabilité des États, créateurs de leur monnaie. L’art contemporain fait la même chose : lui aussi produit des images, les œuvres, et déclare leur valeur. Et tout comme le contribuable qui ne discute pas la valeur de la monnaie qu’il utilise, le public n’est pas habilité à juger les œuvres mises en circulation, un privilège réservé à un groupe très fermé de galeristes et de collectionneurs. Et la valeur de ces œuvres est garantie par celles qui sont stockées dans les grandes collections privées.
Plus concrètement ? Si la banane scotchée par Cattelan vaut 120000 euros, c’est parce que son Hitler, enfant, priant à genoux (Him) ou son Pape écrasé par une météorite (La Nona Ora) en valent plusieurs millions. Si la moindre babiole de Jeff Koons coûte des brouettes pleines d’euros et de dollars, c’est parce que chaque pensionnaire de sa ménagerie de Rabbit et autres Balloon Dogs en valent déjà des dizaines de millions. Pour que la valeur des œuvres ne risque pas de s’effondrer, les collectionneurs ne les revendent qu’en cas de force majeure : divorce, décès ou faillite. Le dernier risque est minime dans la mesure où les grands collectionneurs, ceux qui peuvent se payer du Cattelan, du Hirst, du Koons, du Kieffer ou du MacCarthy, sont tous too big to fail, trop gros pour se casser la figure.
Cattelan colle une banane sur un mur en 2019. Ce qui compte, c’est le concept, l’idée et son prix. Astronomique. Que la banane ait été mangée ou pas, l'argent coule à flots.
L’ART DÉTESTE LE BEAU
Le vrai risque pour l’art contemporain est que les œuvres qu’il met en circulation soient jugées grotesques, inutiles, artificielles, scandaleuses, insultantes... Et, pire que tout, laides. Pourtant, l’art contemporain déteste le beau. C’est Jeff Koons, le courtier de Wall Street devenu l’artiste vivant le plus cher payé, qui le dit. La beauté est déclarée facile parce que les émotions qu’elle suscite sont immédiates.
Elle est accusée d’être élitiste parce que pour créer du beau, il faut du talent: celui de peindre, de sculpter, de dessiner; de rendre une émotion à travers une forme. Le talent n’étant pas également distribué, il est rejeté, déclaré «fasciste». Et comme tout le monde peut avoir des idées, émettre des concepts, nourrir des intentions, on déclare que c’est cela qui fait la valeur des œuvres. Un sculpteur génial mais incapable d’expliquer les intentions qui l’ont guidé, un peintre maîtrisant son art à la perfection mais ne jugeant pas utile de disserter sur ses concepts, sont déclarés nuls comparés à Jeff Koons qui n’a jamais mis la main à la pâte pour créer une œuvre ou à Maurizio Cattelan qui se flatte de ne pas avoir d’atelier et de ne posséder qu’un téléphone pour mener sa carrière. Les œuvres les plus chères mises en circulation par l’art contemporain ne sont jamais fabriquées par ceux qui les revendiquent. Les stars de l’art contemporain ne veulent pas être «bêtes comme des peintres» qui s’angoissent devant leur toile, inventent de nouvelles formes en se salissant les mains.
JE DIS, DONC JE SUIS
Être «bête comme un peintre», l’expression est de Marcel Duchamp, le génie que l’art contemporain revendique comme son père fondateur. En 1917, le sexy frenchy décide d’exposer un urinoir en porcelaine au Salon des indépendants du Nouveau Monde, à New York. Il a acheté cette banale pissotière à la quincaillerie Mott (118, 5th Ave).

Fountain (1917) de Marcel Duchamp (1887-1968)
Exposition au Palazzo Grassi, en 1993, à Venise.

Bouquet de tulipes de Jeff Koons
Paris, 4 octobre 2019. L’œuvre monumentale est inaugurée dans les jardins des ChampsÉlysées, derrière le Petit Palais. L’œuvre a été offerte à la Ville de Paris, en soutien du peuple américain aux Parisiens et Français endeuillés par les attentats de 2015-2016.
Duchamp signe l’immaculée porcelaine d’un Richard Mutt, 1917, la peint en noir et la rebaptise Fountain. Trois traits de peinture, un baptême et un «culot révolutionnaire», voici l’urinoir devenu œuvre. C’est un ready-made. Mais Fountain est refusée au Salon sous prétexte que ce n’est pas une création. Duchamp réplique que c’en est bel et bien une, puisque, lui, un artiste, en a décidé ainsi. Mais les commissaires de l’exposition campent sur leurs positions: «Pas de Duchamp aux Indépendants ! » Ce sera le titre d’une photo de Fountain que Duchamp commande à son ami américain, le photographe Alfred Stieglitz, puis d’un article que l’inventeur des ready-made fait écrire à Louise Norton. La jeune écrivaine française, établie à New York, y édicte le Premier Commandement de l’art contemporain: «Que l’artiste ait fabriqué ou non de ses mains la fontaine n’a pas d’importance. Il l’a CHOISIE. Il a pris un objet ordinaire et l’a placé de telle sorte que sa signification habituelle disparaisse sous le nouveau titre et point de vue, créant une nouvelle perception de cet objet.» Ce qui compte, c’est ce que l’artiste imagine, décide et dit. Il n’a plus besoin de peindre, de sculpter, de dessiner. Il fait un choix et le déclare publiquement.
LA FRANCE SUR LA TOUCHE
Les ultrariches se passionnent pour l’art contemporain. Ils y trouvent une manière de se distinguer les uns des autres. Un milliardaire peut s’acheter autant de voitures de luxe, de yachts et de jets qu’il le souhaite, mais rien ne le distingue vraiment d’un autre milliardaire qui peut s’offrir les mêmes babioles. En revanche, payer des millions pour une œuvre unique ou, mieux, un concept particulièrement audacieux que le commun des mortels trouvera grotesque, voilà la meilleure façon de marquer sa différence. Et un excellent moyen d’afficher sa solvabilité.

Ascension des pois sur les arbres de Yayoi Kusama
Londres, Royaume-Uni, 2009. Installation au Queen’s Walk, le long de la Tamise. L’artiste japonaise dit que sa vie est «un point au milieu de ces millions de particules qui sont des pois».

This Little Piggy Went to Market, this Little Piggy Stayed Home, 1996, de Damien Hirst
Entre avril 2021 et avril 2022, Gagosian confie les clés de sa galerie de Britannia Street à King’s Cross (Londres), à Damien Hirst. Ce dernier expose ses propres œuvres, notamment «Natural History », qui porte sur des animaux conservés dans du formaldéhyde.
Le galeriste Leo Castelli (1907-1999) avait, plus que personne, ce talent. Il disposait aussi des fonds de l’OSS (Office of Strategic Services), le précurseur de la CIA, qui souhaitait briser le monopole de Paris sur la consécration des styles, des écoles, des tendances et des artistes.
À partir des années 1960, les États-Unis imposent leur «soft power» et mettent la France sur la touche. Leo Castelli a été l’instrument de cette politique. Il a inventé l’art contemporain américain. Il a choisi les artistes qu’il voulait entraîner dans ce mouvement et a créé de toutes pièces une clientèle internationale fortunée pour les œuvres que sa galerie new-yorkaise distribuait. Avec lui, les tableaux deviennent «de l’argent sur les murs».
Malgré tout, Castelli détestait l’idée d’être considéré comme le plus grand marchand d’art du monde. Le mot marchand le gênait. Il préférait se présenter comme «un entrepreneur d’artistes». Il ne travaillait que sur le premier marché, c’est-à-dire celui des œuvres tout juste achevées et en quête d’un premier propriétaire. Castelli était donc constamment à la recherche de nouveaux talents, qu’il soutenait financièrement et moralement, jusqu’à ce qu’ils émergent et que la vente de leurs œuvres le rembourse de ses investissements.
GAGOSIAN, LE « REQUIN» CALIFORNIEN
Larry Gagosian, formé par Castelli auquel il a succédé au sommet du marché mondial de l’art contemporain, n’a pas les mêmes pudeurs ni les mêmes délicatesses que son mentor. Gagosian déteste les marchands de tableaux qui se font appeler «galeristes». Il ne voit qu’hypocrisie dans ce genre de coquetterie. Comme lui, les galeristes qui dominent le marché ne seraient motivés que par leur addiction à l’argent. Ils ont trouvé dans l’art contemporain le meilleur moyen pour devenir immensément riches. Mais aucun de ses rivaux n’a jamais gagné autant d’argent que lui. Avec ses galeries aux quatre coins du monde, l’homme, qui a commencé en vendant de mauvaises photos de chatons et de paysages à Los Angeles, a un revenu annuel de 1 milliard de dollars. Il distribue la production des 100 meilleurs artistes contemporains, vivants ou morts, à travers son réseau de vingt galeries qui sont les rendez-vous obligés des 0,001 % personnes les plus riches de la planète. Parti de rien, il fait désormais partie de ce club très fermé. Gagosian, que ses partenaires voire ses amis soupçonnent d’être capable de tout pour empocher quelques millions de plus, reconnaît qu’il n’est intéressé que par l’expansion perpétuelle de sa fortune déjà colossale. À presque 80 ans, «The Shark» (le requin) n’a pas d’héritier, mais ne semble guère se soucier de savoir à qui iront et son immense fortune, et ses fabuleuses collections.
À l’entrée des années 2010, les activités de la «galaxie Gago», toutes orientées vers le profit maximal, prennent un tour beaucoup plus culturel. Larry Gagosian organise l’une des meilleures rétrospectives Picasso jamais proposées au public. Puis une exposition Rubens, qui écrase en intelligence et en éclat tout ce que les grands musées avaient produit jusque-là. La plus puissante des mégagaleries ouvre également une maison d’édition de livres d’art. Elle devient vite, et sans surprise, la première au monde tant par le nombre d’ouvrages publiés que par leur qualité.
McCarthy sème des étrons géants gonflables de Berne à Hongkong. (...) Et plante un arbre de Noël gonflable à l’allure d’un immense sex-toy anal (Tree, 2014), place Vendôme, à Paris.

Larry Gagosian
New York, 7 septembre 2023. Le galeriste américain assiste au vernissage de l’exposition d’Ed Ruscha «Now Then», au MoMa.
L’objectif de ce fort investissement culturel est de transformer le nom Gagosian en une marque fortement identifiée à des pratiques commerciales transparentes et à un véritable souci de diffuser la culture au plus large public possible, même celle réservée habituellement aux initiés. La marque Gagosian doit incarner tout ce que le tycoon Gagosian n’est pas et n’a surtout pas du tout envie de devenir.
Mais l’homme d’affaires a compris que la transformation de l’image de sa galerie est indispensable. Depuis le début des années 2000, l’opinion publique dans le monde se sent agressée par les stars de l’art contemporain, dont la plupart sont représentées par Gagosian. Les scandales se multiplient. Paul McCarthy, affirmant vouloir «emmerder le monde», sème des étrons géants gonflables de Berne (Suisse) à Hongkong (Chine). Koons danse sur des montagnes sans cesse plus vertigineuses de dollars en produisant des œuvres qu’il ne réalise pas, sur la base d’idées qu’il vole à la culture populaire. Andres Serrano ressort de ses placards des bocaux remplis d’urine où sont plongés des crucifix. McCarthy, encore lui, plante un arbre de Noël gonflable à l’allure de sex-toy anal géant (Tree, 2014), place Vendôme, à Paris. Anish Kapoor installe, en 2015, le Vagin de la reine (10 m de haut) dans les jardins du château de Versailles. Dans différentes sculptures, dont il ne fait que définir le concept, McCarthy transforme Blanche-Neige en porn star (White Snow, Party, 2013).
CHOUCHOUTER LE PUBLIC
Ces années-là sont justement celles où le marché de l’art contemporain s’emballe. Chaque année, à partir de 2013, le chiffre d’affaires global de cette industrie progresse de façon hallucinante. Une conclusion s’impose : si les scandales amusent et exaspèrent la foule, ils galvanisent les pulsions d’achat des ultrariches. Selon le paradigme de Duchamp, toute personne se déclarant artiste peut déclarer «œuvre» n’importe laquelle de ses propositions. Plus la déclaration est assourdissante et insulte le sens commun, plus l’artiste déclarant se montre inepte ou révoltant, plus l’œuvre est valorisée. Sans scandale, il n’y a pas d’art contemporain et sans lui disparaît l’une des industries les plus rentables
qui ait jamais existé sur Terre.
Mais un scandale de trop pourrait tout emporter. Les galeries, tout en laissant une liberté de création totale aux artistes, doivent rendre leurs productions plus acceptables. Toutes les mégagaleries suivent l’exemple de Gagosian. Leur discours pose en principe non négociable la liberté d’expression totale des artistes, au risque de devenir scandaleux. Mais elles doivent aussi prendre soin du public, y compris de celui qui jamais ne pourra s’offrir l’une de ces œuvres. On ne demandera pas aux artistes de se museler mais on va se donner les moyens de favoriser l’acceptabilité des œuvres par le commun des mortels. L’art contemporain doit enfin devenir l’art de ses contemporains.
Il y a une véritable dimension religieuse dans cette ouverture des mégagaleries. Il faut amener le public à la foi. On veut le convertir. Les missionnaires chargés de cette œuvre sainte sont les meilleurs directeurs de musées publics ou privés, les grands écrivains, les meilleurs penseurs, les journalistes de renom, que l’on va débaucher à prix d’or pour qu’ils prêchent ce nouveau credo au peuple.
Mais l’entreprise de conversion coûte cher, très cher. L’Église, chahutée par la Réforme, s’était saignée pour construire les églises et les cathédrales baroques dont la splendeur inégalée l’avait sauvée. Les mégagaleries doivent suivre la même voie, à condition bien sûr d’en avoir les moyens. Hauser & Wirth, Zwirner, Pace et White Cube sont les seules maisons capables de relever le défi que leur adresse Gagosian. À leur tour, ces «Mégas» se sont lancées à la conquête de places fortes, un peu partout dans le monde, pour imposer leur marque. La seule règle qui vaille est celle du «grow or go». Qui ne peut pas suivre quitte la table et va jouer en division inférieure... ou disparaît tout simplement.
KIDNAPPER LES ARTISTES
Hauser & Wirth a trouvé les moyens non seulement de ne pas se laisser distancer mais aussi de talonner Gagosian. Le mar- chand d’art suisse dispose d’un réseau international de galeries aussi dense que celui qui contrôle malgré tout encore l’essentiel du marché. Hauser & Wirth a récemment ouvert des mégagaleries à Monaco, Minorque, Los Angeles. Depuis quelques jours, la galerie dispose d’une adresse prestigieuse à Paris: les anciens bâtiments d’Europe 1. Dans ces espaces somptueusement aménagés, le quidam est invité à communier avec les ultrariches dans l’adoration de l’art contemporain et de ses sulfureux prophètes, les artistes – que les galeristes se disputent et s’arrachent. Quand le peintre américain Julian Schnabel et l’artiste japonaise Yayoi Kusama quittent Gagosian, l’une pour Zwirner, l’autre pour Pace, c’est une terrible blessure à l’ego du premier et une perte financière considérable. Mais il n’est pas facile de s’assurer la loyauté de ces stars. L’un des arguments pour inciter « ses » artistes à rester, tout en kidnappant ceux des concurrents, réside dans la capacité des galeristes à donner une visibilité internationale immédiate aux vedettes installées comme aux nouvelles recrues.
La Russe Valentina Volchkova dirige la galerie Pace de Genève après avoir eu les mêmes responsabilités à Paris et à Londres. Elle confirme que nouer un lien puissant et durable avec les artistes est vital pour tous les grands acteurs du marché de l’art contemporain: «C’est la condition même de la pérennité d’une galerie. Un galeriste qui réussit est celui que “ses” artistes ne quittent pas.
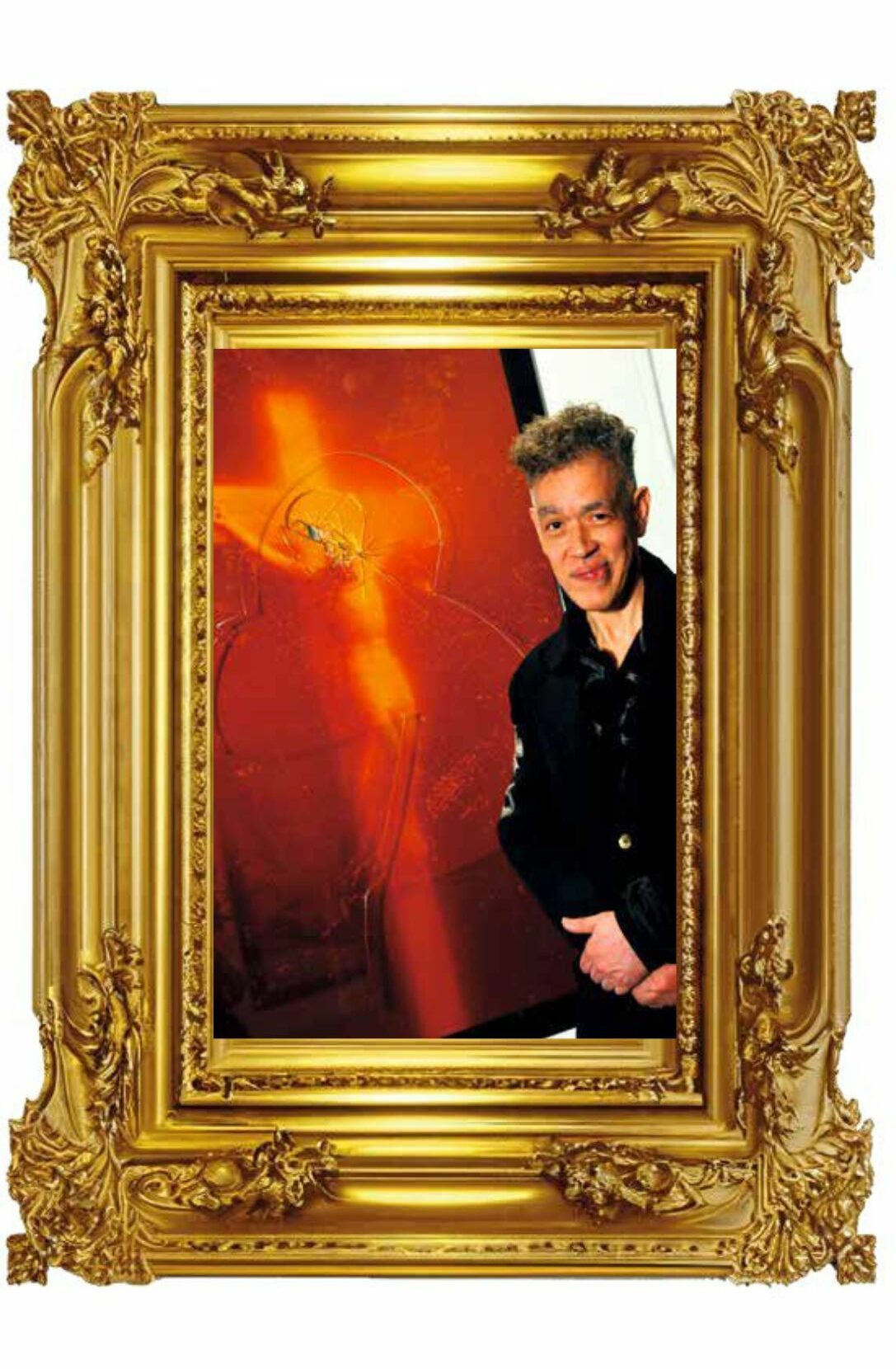
Piss Christ, 1987, d’Andres Serrano
Avignon, 5 septembre 2011. L’artiste américain, à la Fondation Lambert, devant son œuvre vandalisée.
Nouer un lien durable avec les artistes est vital pour les acteurs
du marché de l’art.
C’est le cas d’Arne Glimcher, le fondateur de Pace. Aujourd’hui, si les grandes galeries inaugurent de nouveaux espaces, elles sont moins motivées par le souci de tenir leur rang face à la concurrence que par le désir de préserver une relation forte avec des artistes qui attendent que nous leur offrions une visibilité mondiale. Quand Pace a ouvert une galerie à Paris, l’enthousiasme du Japonais Yoshitomo Nara pour cette ville a beaucoup compté dans notre décision. Et, si nous envisageons de nous implanter en Afrique, c’est parce que nos artistes veulent être vus et reconnus sur ce continent qui les inspire tant.»
Désormais, les artistes veulent être adorés de leur vivant. Ils n’ont plus la patience d’attendre une reconnaissance universelle que seuls les musées pouvaient leur offrir, mais le plus souvent à titre posthume.
FAIRE DU BRUIT ET DES AFFAIRES
Mais si les «mégas» s’affrontent pour séduire les artistes vivants, ils se déchirent avec tout autant de férocité pour mettre les morts de leur côté. Depuis une dizaine d’années, la gestion des successions d’artistes est devenue un filon très rentable. Il s’agit pour le galeriste de trouver les moyens de s’entendre avec les héritiers et les ayants droit pour obtenir la gestion des œuvres d’un artiste décédé. L’exercice est difficile, complexe, juridiquement dangereux. Personne ne le maîtrise mieux que Hauser & Wirth, qui contrôle aujourd’hui une quarantaine de successions. C’est tout à la fois un pactole et une grosse responsabilité. Il faut en effet rentabiliser l’héritage en l’adaptant au goût du jour, sans le trahir pour ne pas encourir les foudres des héritiers légitimes.
Faire du bruit et des affaires. C’est à cela que servent les quelque cent mégagaleries que les cinq plus grands marchands d’art au monde ont dispersées partout où il y a des âmes à convertir et des millions à ramasser. On estime que la valeur totale des œuvres stockées ou en circulation serait supérieure à 1000 milliards de dollars.

« The Currency » de Damien Hirst
Londres, 11 octobre 2022. Le Britannique brûle mille de ses œuvres dans six incinérateurs en verre, à la Newport Street Gallery, dans le cadre de son exposition «The Currency », après les avoir vendues sous forme numérique (NFT).
